Littérature et poétique taurines en Espagne et en France
Yves Lebas
Arles 20 décembre 2015
5ème Salon du Livre
Auberge des Passionnés
ARLES 18 au 20/12/2015
Nous avons tous vécu ces moments d’après-corrida où l’on se dit qu’on eût mieux fait de rester chez soi à lire un livre sur la corrida que d’être allé s’ennuyer aux arènes. Et s’il est toujours une petite voix pour nous dire « n’exagérons pas ! », reconnaissons qu’en cette période de l’année nous n’avons guère le choix… Et puis nous savons bien que, comme le proclame joliment Jean-Marie Magnan « La corrida est une mémoire ». Il arrive même que ce soit un imaginaire si, comme l’affirme un adage un peu amer, « la meilleure corrida est toujours celle où l’on n’était pas ». Ne faisons-nous pas tous un peu partie de la « Peña del que no la vió » ? Cette Peña créée pour mettre un peu de baume au cœur de cet aficionado fou d’Antoñete qu’un besoin naturel, pressant et irrépressible, empêcha d’assister au triomphe de son torero admiré, à Madrid face à Cantinero.
Et quoi de mieux que poèmes, récits, romans, nouvelles, essais ou biographies et leurs mots pour nourrir et développer notre mémoire et notre imaginaire taurins ? Nous avons besoin de prolonger le saisissement et l’émotion que provoquent les instants fugaces d’une faena, nous aimons à en relire la description ou avons besoin d’en retrouver la magie. Ecrire et lire sur la corrida c’est retrouver le toro bravo et son combat à travers ces « toros d’encrier » que poursuit Alain Riemann comme d’autres poètes.
Bien sûr, comme dirait Leiris, toréer ou écrire, le risque n’est pas le même. Mais, pour reprendre ce qui reste un cliché bien connu des toreros, la plus grande peur n’est-elle pas celle du ridicule ? « Hacer el ridículo » dit-on en espagnol où l’on sait mieux qu’en français distinguer l’être du paraître. Et cette peur là on peut l’avoir que l’on torée, que l’on écrive… ou que l’on donne une conférence !
La tauromachie est une histoire que l’on se raconte d’abord, que l’on raconte ensuite. S’il nous faut commencer par l’avoir vu, ce « Yo lo ví » (Moi, je l’ai vu) qu’écrit Goya au pied de l’une de ses tauromachies, la narration a besoin de mots. Or ceux-ci sont pour la plupart issus d’un vocabulaire qui a forgé bien des métaphores qui relèvent de « cette source inépuisable du parler taurin qui est au cœur même d’une irréductible espagnolité » selon le mot prêté à Bergamín par Antonio Muñoz Molina. Il y a là un premier défi pour les écrivains français que de faire partager ce parler taurin, langage étrange sinon étranger pour leurs lecteurs, et une vraie différence avec les auteurs espagnols pour qui il est un parler qui nourrit leur quotidien.
Les chroniqueurs sont les premiers à y être confrontés. Ils peuvent s’en tenir au très ésotérique « il lui para les pieds à coups de capote vulgaire » selon la chronique qui rapporte la tentative tauromachique de Montherlant, s’en amuser comme Zocato évoquant combien la « toréabilité » d’un lot de toros d’une corrida à Dax est un concept qu’il « sera difficile de placer à un chargé de mission dans un dîner mondain à Besançon », ou le dépasser en créant des images propres au parler français comme Jacques Durand imageant une chicuelina « comme un café serré ».
Les traducteurs, bien sûr, les suivent de près. Comment rendre compte du « parler taurin » et garder la fulgurance de l’image poétique quand Lorca leur propose :
« El día se va despacio/la tarde colgada a un hombro/dando una larga torera/por el mar y los arroyos » [1]
Si le jour qui s’en va doucement ne pose pas de problèmes majeurs, comment reprendre l’image du soir à l’épaule qui recouvre mer et ruisseaux comme la cape au-dessus du taureau ? Cette « larga » est-elle une « longue passe » qu’une note en bas de page détaillera pour le lecteur béotien comme dans la traduction de la Pléiade, ou faut-il dire une « cordouane » au risque de l’imprécision tauromachique autant que de la laideur sonore et l’incompréhension pour la plupart des lecteurs ?
Est-ce cette difficulté qui explique pourquoi les auteurs français qui évoquent ou s’inspirent de la tauromachie ont largement privilégié la narration, alors que c’est la poésie plus que la prose qui s’est nourrie de la corrida en Espagne ? On connait les grands poètes dits « de la génération du 27 », les Lorca, Alberti, Aleixandre, Juan Ramón Jiménez, et autres Gerardo Diego ou les frères Machado qui, aficionados ou non, se sont inspirés du toro et de la tauromachie … plus près de nous, la tradition se poursuit avec José Hierro, Francisco Umbral, Rafael Azcona ou Carlos Marzal, et il existe aujourd’hui un blog exclusivement consacré à la « Poesía Taurina ».
Ecartons ce qui pourrait être une explication si l’on croyait, avec Flaubert, que les français n’aiment pas la poésie. Mais remarquons avec Florence Delay que, en matière poétique, « au-delà des Pyrénées, l’invention et l’aventure n’ont pas rompu avec la tradition ni avec l’ordre métrique », non par conservatisme mais comme le déclare Gerardo Diego :
« Nous faisons des dizains, nous faisons des sonnets, nous faisons des stances parce que nous en avons envie. L’envie est sacrée. […] Mais il y a une différence avec nos raisonnables aïeux du XVIIIème siècle. Pour eux, la strophe, la sonate ou le quadrillage étaient une obligation. Pour nous, non. Nous avons appris à être libres ».
Cette capacité d’affirmer sa liberté dans un cadre qui préserve ses règles est une caractéristique lourde de la culture espagnole, que Menéndez-Pidal remonte à la fin du Moyen-Age et que l’on retrouve dans le théâtre classique espagnol du siècle d’or, comme dans la tauromachie ou le flamenco. Cette absence de rupture stylistique contribue aussi à éviter la distanciation entre expressions artistiques populaires et élitistes. Manuel Machado qui disait « communier avec Montmartre et la Macarena » et dont « le désir premier eût été d’être un bon banderillero plutôt qu’un quelconque poète » illustre cette proximité :
« Tal es la gloria Guillén,/de los que escriben cantares:/oír decir a la gente/que no los ha escrito nadie./[…]Procura tú que tus coplas/vayan al pueblo a parar;/aunque dejen de ser tuyas/para ser de los demás »
« La gloire est ainsi faite Guillén,/ pour ceux qui écrivent des chansons:/Entendre dire/que personne ne les a écrites./ Fais en sorte que tes coplas/se retrouvent au sein du peuple./Qu’importe qu’elles ne soient plus tiennes/pourvu qu’elles soient à tout le monde »
Et une copla fameuse la résume – « Los toros y el cante/son hermanitos gemelos,/su pare se llama el arte /y su mare el sentimiento » – (« Toros et cante sont comme des frères jumeaux, leur père se nomme l’art, leur mère le sentiment »)
Les grands toreros aussi nous émeuvent qui disent librement les règles de la tauromachie, qui les habitent d’art et sentiment. Ils expriment alors cette dimension poétique de l’Espagne ou plutôt, comme disait Cocteau, ce pays qui est « un poète en bloc ». Comme la poésie et les coplas la tauromachie relève d’une culture populaire qui vient du peuple et retourne au peuple, usant d’un vocabulaire et une grammaire suffisamment établis pour se transmettre de bouche à oreille et où la créativité de chaque artiste provient de sa propre personnalité, de sa capacité à imprimer une couleur et un rythme particuliers à ses gestes, à transmettre une émotion qui lui soit propre, à éveiller chez le spectateur un questionnement imprévu.
Difficulté du vocabulaire, traditions culturelles plus élitistes, expression artistique née dans des circonstances historiques propres à un territoire particulier (l’Espagne et, dans cette Espagne multiple, plus particulièrement en Andalousie), on comprend bien que l’objet taurin soit originellement pour l’écrivain français, une réalité externe, un fait exotique et étrange. Là où l’espagnol se reconnaît, le français va se projeter, là où l’espagnol vise à prolonger et partager une émotion avec un lecteur qui la connait, le français se doit de l’expliciter et la faire comprendre à un lecteur qui l’ignore, pour le premier la tauromachie est un vécu, pour le second une découverte.
Les premiers écrivains français qui traitent de la tauromachie au début du XIXème rapportent de leur voyage en Espagne un monde exotique où l’amour est affirmation de liberté et le courage l’expression de l’héroïsme individuel de personnages issus du peuple. La duchesse d’Abrantès et Abel Hugo venus et repartis d’Espagne dans les fourgons de la malheureuse aventure espagnole de Napoléon rapportent des récits de voyage et même un roman – « Le Toréador » – pour la duchesse. On retrouve dans ce roman, considéré comme le premier roman taurin, bien des ingrédients et la trame de ceux qui suivront : le choix impossible entre deux amours est résolu par la mort du torero sous les coups de corne du toro. « La Militone » de Gautier ou les « Arènes Sanglantes » de Blasco Ibañez, « Le Torero Caracho » de Gómez de la Serna ou « Sang et Lumière » de Joseph Peyré reprendront la thématique en y imprimant leur manière.
Apparait ainsi un premier apport de la littérature française à la littérature taurine, mais aussi plus largement à la diffusion d’une culture taurine au-delà de ses terres originelles. Par la primauté du traitement romancé de la corrida et son contexte dans une autre langue, la duchesse d’Abrantès ouvre la voie à ce que la tauromachie prenne un sens au-delà de ses frontières géographiques mais aussi de son strict spectacle. Plus loin et beaucoup plus profondément, en faisant mourir Carmen aux portes des arènes sous le poignard de Don José, Mérimée puis Bizet et ses librettistes Meilhac et Halévy, feront de la métaphore taurine une métaphore universelle : toréer le toro, le destin ou ses amants c’est dire sa liberté, sa volonté de vivre libre au prix de la vie même… la corrida, comme diraient Sartre ou Beauvoir « donne à penser » ! Lorca l’a résumé d’un mot en disant que la corrida est l’art le plus cultivé qui soit. Même, et surtout peut-être, si l’on partage la définition de Bergamín, paradoxale pour nous français, d’ « art analphabète ».
N’est-elle pas particulièrement plaisante cette contribution de la France, à travers sa littérature, dont on sait combien elle est constitutive de son acception de la culture, au développement de la tauromachie, dont on sait combien elle est enracinée dans les terres d’Espagne ? Et pour qui aime les paradoxes, que ce soient des « napoléoniens » qui en aient été les précurseurs a quelque chose d’heureuse revanche d’une culture utile sur une guerre inutile qui n’est pas pour déplaire…
Si les écrivains espagnols s’interrogent sur le sens historique et social d’une pratique propre à leur pays, qui manifeste le goût pour une fête collective et multiforme mais aussi tragique, les français vont approfondir le pourquoi d’un saisissement esthétique qui les touche et interroge au plus profond l’essence même de l’humain. Ainsi Gómez de la Serna s’amuse et caricature une corrida dont il illustre le caractère contradictoire, alors que, en écrivain naturaliste, Blasco Ibañez en décrit tous les aspects, célèbre la grandeur et les lumières et questionne les ombres. Si Unamuno s’offusque de la passion de l’aficionado, Ortega y Gasset y voit l’affirmation d’une identité espagnole originale dans l’Europe des nations. En France, Montherlant, Leiris ou Bataille se veulent observateurs d’un rituel qui plonge ses racines dans des interrogations ontologiques : rite mithriatique du sang du taureau qui ensemence et nourrit pour le premier, rapport à la mort et à la vie ou à la sexualité pour les deux autres.
Mais il est un autre apport de Leiris et Montherlant qui nous intéresse ici : le rapport à la langue taurine, celle dont on disait la difficulté pour les auteurs français. Leiris qui aborde la corrida comme essayiste (brillant) et chroniqueur (fade) cherche aussi à s’en saisir à travers la poésie. Sa démarche, dont Annie Maïllis a tracé les inquiétudes, est révélatrice du glissement de l’écrivain d’une langue taurine importée vers un parler taurin qui s’assume. Les premières éditions de ses poèmes s’accompagnent d’un lexique pour expliquer les termes techniques et espagnols qu’il emploie. Il le supprimera au cours des éditions suivantes appliquant par anticipation le manifeste de Florence Delay traduisant Bergamín, « congédiant le glossaire et versant tout le lexique taurin en pensée française ». Ainsi son poème « Trastos » est poème et glossaire à la fois qui nous donne à percevoir comment ces « outils usagés » que sont les trastos recèlent un sens caché et profond, un de ceux, nombreux, de la corrida :
« A sa main droite la colonne de lumière/à sa main gauche celle des nuée/ il marche/ A sa main droite/le pivot diamanté des souffrances/à sa main gauche le linge rougi/ par le sang futur de la pluie/il s’avance et son destin oscille entre le minuit des cornes et le midi de l’épée. »
Appropriation progressive d’un art né ailleurs et que, aux côtés d’acteurs directs de la corrida, éleveurs, toreros, organisateurs, illustrent des écrivains mais aussi ces poètes qui revendiquent avec André Velter un « français nomade » riche des apports d’autres langues, ou les mots pour le dire ne sont plus une frontière mais deviennent un trait d’union. Surgissent ainsi de plus en plus de poètes français pour qui la corrida devient source d’inspiration au-delà de toute référence espagnole importée : Riemann ou Velter mais aussi Dejus ou Duvert rejoignent les Marzal, Félix Grande ou Angel González qui poursuivent une si riche tradition espagnole. Mettons à part Catherine Le Guellaut : elle se plait à conjointer poèmes en espagnol et en français, mise en scène explicite de nos différentes similitudes.
Ce faisant ils participent de cette évolution de la corrida qui n’est pas seulement une tradition locale mais est une manière, originellement enracinée dans un territoire et une histoire, de poser, illustrer et résoudre de manière toujours à recommencer les contradictions de tout homme, ces contraires liés: la vie et la mort, la vérité et le mensonge, le beau et le laid, l’amour et la haine, le masculin et le féminin, la nature et sa domestication, la brutalité et l’intelligence, la fête et la tragédie, l’individuel et le collectif, l’ombre et la lumière… On pourrait poursuivre longtemps cette liste de binômes contradictoires que met en scène un art populaire qui est aussi le plus philosophique des arts. Il scandalise ? mais que serait un art qui ne fouaille pas au plus profond de nos interrogations d’homme ?
N’ayons pas peur pour l’avenir de la corrida si nous savons en expliquer l’universalité, en transmettre les valeurs et la première d’entre elles, celle de la liberté de penser sur notre humaine condition et ses contradictions, autrement dit l’apprentissage de la tolérance. Est-ce espagnol ? Est-ce français ? Ni l’un, ni l’autre et tous les deux à la fois, tauromachie universelle dont rêvait Bergamín.
Un journaliste me demandait si, au terme de ce petit voyage littéraire je pensais que l’on devenait meilleur aficionado. Je ne suis pas sûr que l’on sache mieux si tel ou tel toro méritait une pique de plus ou de moins, s’il fallait le citer de loin ou commencer la faena par quelques passes de castigo, si le « julipié » est une efficace invention ou une insupportable et vilaine tricherie. Mais si l’on peut se dire que la tauromachie est une merveilleuse manière de réfléchir sur nous-mêmes, ça ne me paraîtrait pas si mal.
___________________________________________________
[1] La Rédaction se devait de rendre lisible l’image dont elle a accompagné l’amorce de cette page :

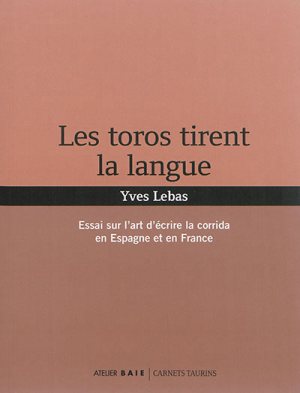 Yves Lebas a publié :
Yves Lebas a publié :
LES TOROS TIRENT LA LANGUE
160 x 205 mm, 200 pages – 16 €
ATELIER BAIE ,
collection CARNETS TAURINS , (septembre 2015)
Note de l’éditeur :
Y-a-t-il une littérature taurine en France et en Espagne ? Et qu’est-ce qu’une littérature taurine ? Que dit la façon d’écrire sur les toros en Espagne et en France des ressemblances et différences entre ces deux pays ? Est-ce le même langage ? Quelles valeurs et quelle vision de la corrida et par conséquent, du monde, véhiculent ces écritures ?
Yves Lebas éclaire ce labyrinthe avec des analyses fines nourries d’un impressionnant savoir littéraire et taurin. Il donne ainsi, au passage, une vaste et passionnante anthologie des œuvres enfantées par la langue taurine. On s’en doutait, c’est une langue bien chargée

